Semaine chargée pour la productrice Deena Abdelwahed : ce jeudi 15 février, elle présente à la Gaîté Lyrique le live de Jbal Rrsas, son second album sorti l’année dernière, toujours signé chez sa maison-mère, InFiné Music. Dès le lendemain de cette soirée, la musicienne libérera un E.P. de trois remixes tirés de son projet par DJ Plead, 33EMYBW et Ehua, preuve s’il en fallait d’un mindset sans œillières ni frontières, qui guide sa création musicale depuis plus d’une décennie désormais : « j’adore le travail de ces trois artistes, dont je joue souvent les titres lors de mes DJ sets » précise la Tunisienne. « C’est d’ailleurs Ehua qui assurera ma première partie, ce jeudi ».
Compositrice de noise électronique, issue des très sombres collectifs tunisiens World Full Of Bass et Arabstazy, Deena cherche désormais la lumière : « l’art est une extension, une sublimation d’une idée que l’on n’arrive pas à exprimer autrement. Et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle une large part de la production musicale actuelle est négative, sombre, mélancolique. Le monde l’est. Seuls certains artistes, très peu en fait, parviennent à tirer des choses très belles et lumineuses de l’époque. Parvenir à exprimer de la résilience de tout le merdier actuel, ça m’impressionne beaucoup. »
Chantre de territoires musicaux « en mouvements », Deena Abdelwahed cite la oudiste palestinienne Kamilya Jubran, le rappeur algérien TIF ou le producteur d’origine angolaise Nazar. Elle nous a reçu dans son petit studio parisien. Au menu ? Sa récente résidence à Atlanta, son amour de l’abstraction, ou l’expression des luttes, des deux côtés de la Méditerranée.
Tu as l’image d’une musicienne qui avance en solo, mais tu es rarement seule pour interpréter ta musique. Étais-tu également accompagnée pour la production de ton dernier album Jbal Rrsas ?
Je compose seule, mais en studio ou sur scène, je m’entoure. Khalil Epi, m’accompagne sur les arrangements, depuis la sortie du E.P. Flagranti (sorti en 2023 sur InFiné et Shouka, NDA). Khalil est un putain d’arrangeur qui sait exactement où se positionner sur mes morceaux. Tu le verras également sur scène avec moi à la Gaîté Lyrique cette semaine par exemple, puisqu’il m’accompagne également sur scène, lorsque je joue Jbal Rrsas. Et puis tu sais, je suis seule face à la création, mais je fais beaucoup écouter mes maquettes aux musiciens et musiciennes qui m’entourent. D’autant qu’ils ne sont pas forcément dans la même musicalité que moi, donc c’est trop bien ! Ce sont parfois eux qui me stoppent dans mes recherches. Sans eux, je partirai peut-être naturellement trop dans l’expérimental ! J’écris pour toucher des échantillons de gens très différents. Je ne veux pas toucher une masse, je ne veux être le porte-étendard de personne. Je veux que ma musique touche quelques personnes, mais qu’elles soient très variées ! Je le vois dans mes reports d’achats de morceaux transmis par mon label, ça va de la Suède au Kazakhstan, j’adore l’idée. Moi, Tunisienne vivant à l’époque au Qatar, j’ai été touchée par les musiques afro-américaines, j’aime cette dynamique de territoires musicaux qui se déplacent, je trouve cela sain.
On t’imagine assez exigeante dans tes goûts musicaux.
Disons que tu as peu de chance de me trouver en train d’écouter des boucles de derbouka sur un track de gabber, ça c’est sûr (rires) ! Mais tu sais, je me suis formée à la musique dans la patience. Donc mon expérience d’apprentissage de la musique, c’est d’abord une expérience de la lenteur, de l’attente. Parce que j’ai commencé par le Deejaying. Donc j’ai passé de très longs moments à écouter, et de manière très attentive, tous les genres musicaux. J’ai étudié de nombreuses palettes musicales, sans œillères, ni a priori, car je ne suis pas issue d’une formation académique. En Tunisie, au départ, j’étais évidemment très proche des scènes noise et expérimentales de l’époque, mais depuis, j’ai largement exploré tous les genres. Il n’y a que le rap, finalement, que je n’écoute plus vraiment.
Tu reviens justement d’une résidence à Atlanta, tu ne t’es pas jetée dans la Trap ?
Franchement, pas du tout. Jazz, soul, nu-soul, conscious rap ou trap, j’ai un sacré catalogue stocké en tête, s’il date d’avant 2010. En fait, depuis que je fais de la musique, je n’arrive plus vraiment à écouter de rap… C’est étrange non ? C’est arrivé au moment où j’ai commencé à faire de la musique. A partir du moment où je me suis mise aux machines moi-même, j’ai comme mis à jour quelque chose qui ne fonctionnait pas pour moi, dans le rap de cette période. Je crois que cela vient de la déconnexion entre les parties instrumentales et les voix. Je trouve que c’est trop souvent incohérent, comme si la présence de l’un gênait l’existence de l’autre. La musique ne doit pas être cosmétique, je n’aime pas que les choses soient posées de façon aléatoire, simplement pour appuyer un style ou simplement pour mettre en avant une voix. Après, récemment, le rappeur algérien TIF m’a mis une énorme claque, j’adore ses placements. Son flow fusionne avec les prods, c’est fou.
Qu’est-ce que tu tires de ton expérience à Atlanta, ville hautement symbolique, berceau du mouvement des droits civiques américain ?
La qualité du vivre ensemble à Atlanta mec ! J’en étais jalouse, vraiment. Atlanta est une ville humaine, healthy, hyper fonctionnelle. Atlanta est une ville noire, où la communauté afro-américaine parvient à valoriser et à enrichir ses membres de l’intérieur. Évidement il y a aussi plein de gens dans la merde mais c’est plutôt lié au systeme fédéral américain. C’est fascinant de voir comment cet ancien bastion esclavagiste est parvenu à se réconcilier avec lui-même, pour y faire naître le mouvement américain des droits civiques. Les habitants y parlent leur propre langue militante depuis le début. Il y a une étonnante maîtrise des archives comme des histoires personnelles, écrites ou orales. Il y a cette connexion, très forte, entre les habitants, leur territoire et leurs ancêtres. À Atlanta, chacun sait dans quelle rue habitaient leurs ancêtres réduits en esclavage par exemple. La transmission, même si elle est liée à des traumas, se fait de façon naturelle, presque organique, et à l’échelle d’un quartier. Du coup il y a ce côté très peaceful à Atlanta je trouve, lié au fait que les gens ne sont pas en guerre avec leur environnement social. Dans les pays arabes et en Europe aussi d’ailleurs, quand ça ne va pas, on s’expatrie. On a très facilement tendance à rompre avec son propre territoire. Européens ou Arabes, quand on trouve que ça ne va pas, on coupe avec nos parents ou nos grands-parents. Ça brise les territoires.
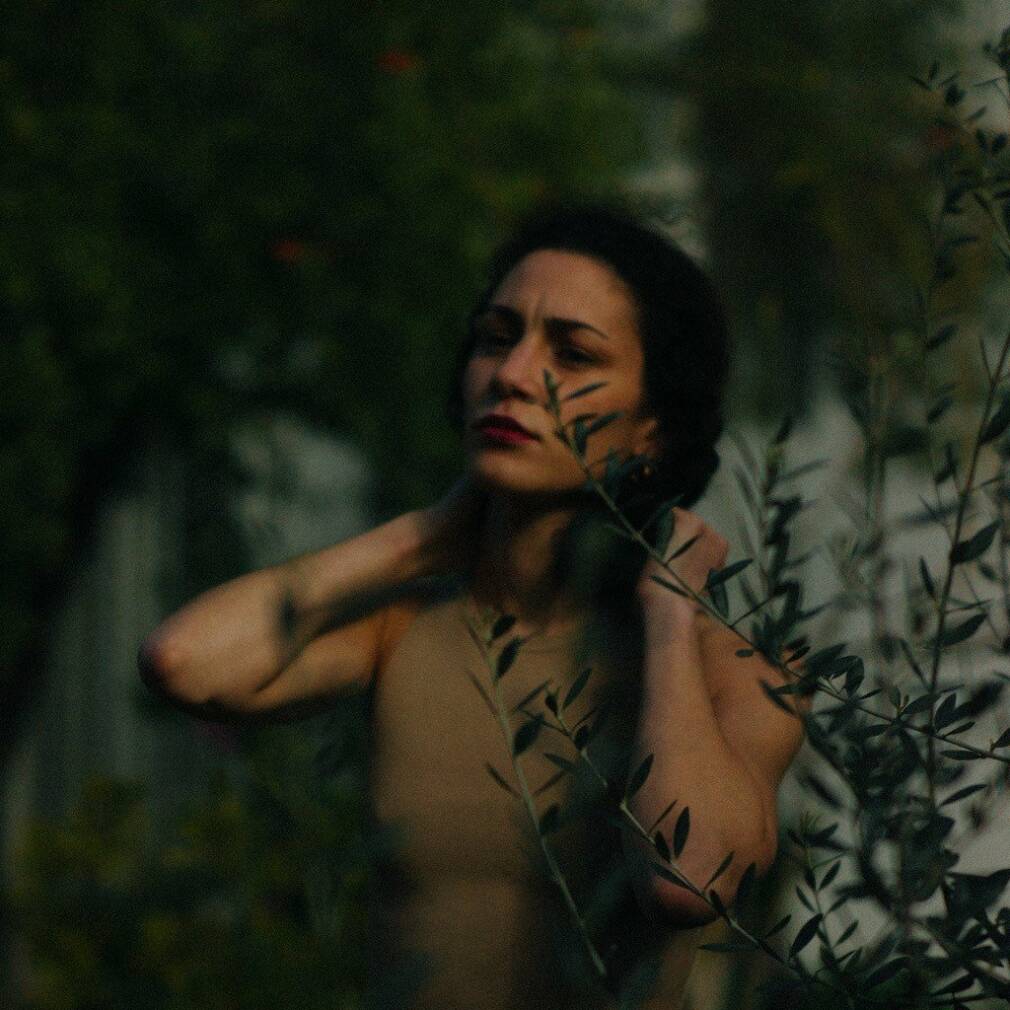
Il y a une dimension militante dans ta musique, est-ce complexe d’exprimer ses engagements à l’époque de la grande société du spectacle 2.0 ?
C’est effectivement devenu hyper complexe de formuler, de mettre scène un message, politique ou social disons. Parce que les réseaux sociaux ont hypé une forme de branding autour de l’engagement et du militantisme, et moi je ne veux pas alimenter cet algorythme de merde. L’idée c’est de pouvoir impacter les gens, sans participer au grand spectacle des socials. Mais c’est délicat et je passe beaucoup de temps à y réfléchir, sûrement trop d’ailleurs. Je trouve que la poésie reste un des meilleurs moyens de pouvoir s’exprimer, de pouvoir faire passer une forme de message la plus pure possible, sans se faire attaquer personnellement. Cela fait des siècles que la critique du pouvoir est ainsi formulée. Dans la collection des contes d’origine indienne, Kalîla wa Dimna (ndlr : le recueil de fables animalières qui inspirera d’ailleurs par la suite les Fables de Jean La Fontaine.), l’auteur établissait dès le VIIIème siècle des remarques morales ou des reproches au roi, par l’entremise d’un renard et d’un corbeau.
Plus de poésie, moins de publications Instagram.
Mais écoute, si par exemple je me suis passionnée pour la quête identitaire et les revendications du musicien angolais Nazar, c’est d’abord parce que j’ai été touchée par sa musique. Je me suis intéressée à la guerre civile en Angola grâce à la poésie d’un artiste, pas grâce à ses publications Instagram. Poster Free Palestine sur les réseaux n’est qu’une invitation à prendre part à un brouhaha. Cela n’incite ni à s’instruire, ni à s’engager. Cela ne donne aucun outil de connaissance ou de lutte. Ce n’est que du bruit. Ce bruit, il peut même avoir des effets franchement nocifs. Il y plus de dix ans, quand les Femen vont manifester seins nus face au palais de justice de Tunis en soutien à Amina, l’effet est catastrophique. Incompréhension ici, mauvaise interprétation en Europe… Résultat ? Les petites avancées gagnées en Tunisie ont pris une grosse claque en arrière. Parce qu’on ne lutte pas de la même façon en Europe qu’en Orient, il faut l’accepter. Pareil pour les formes de luttes initiées par les mouvements Queer ou LGBTQI+ aux États-Unis, elles ne sont pas des kits prêt à l’emploi qu’on peut importer et plaquer comme ça, sans réfléchir, sur n’importe qu’elle société dans le monde. Il existe un différentiel de narration des luttes entre l’orient et l’occident, il faut l’intégrer, sinon, le résultat obtenu est dramatiquement contre-productif.
C’est la question de l’identité et du positionnement qui se pose ici.
C’est ça. Moi, mon positionnement musical par rapport à mon identité arabe, c’est justement qu’il n’y en a pas. Dans ma pratique de la musique, n’ai pas à me positionner par rapport à mon identité. Je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, je ne me sens pas forcée d’en faire abstraction ou de gommer quoi que ce soit, comme certains le font. Et à l’inverse, je n’ai pas de parti pris, je ne compose pas avec le manifeste de la musique électronique arabe sous le coude. À chaque sortie d’album, on me demande presque de justifier la provenance et l’origine de tel sample, telle boucle. Expliquer l’usage et la provenance d’une rythmique, tunisienne par exemple, je le fais au studio avec tel collaborateur ou telle productrice, parce qu’il ou elle a besoin de comprendre l’origine et la symbolique d’un son pour pouvoir l’arranger ou l’utiliser. Ça, d’accord. Mais pourquoi devrais-je le faire dans la presse franchement ? J’espère être au-delà de ça désormais. J’espère vraiment que d’ici quelques années, je n’ai plus à justifier les composants sonores que j’utilise dans ma musique. L’essence même de ma musique, c’est de la technique pure appliquée à des formes de poésie, d’expressionnisme, d’imaginaires. Moi, je suis au service de mes propres abstractions. Je ne suis pas au service des musiques électro-arabes je-sais-pas-quoi. Je décortique de la matière, puis je la repositionne à ma façon, selon mes pulsions, mon imagination, mes idées. Kamilya Jubran est oudiste, d’accord ? Mais le but de Kamilya Jubran, ce n’est pas du tout de perpétuer la tradition du oud. Le but de cette musicienne, c’est de créer, de façon complètement libre et instinctive, de la musique qui puisse servir les mouvements de son chant et ses paroles. Moi, c’est pareil.
Deena Abdelwahed, Jbal Rrsas Live à la Gaîté Lyrique à Paris, le 15 février (Guest : Ehua).
Jbal Rrsas remixes, sortie sur InFiné le 16 février.

