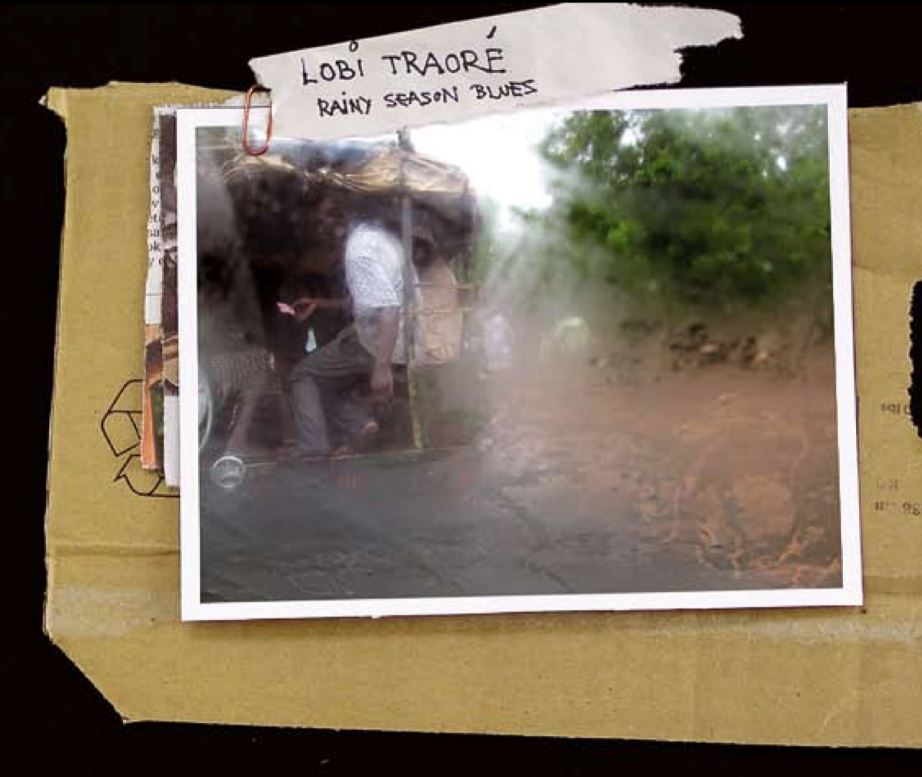Cinq fois primé comme label de l’année, lors des Womex 2014, 2015, 2016 et 2017 et 2018 le jeune label Glitterbeat a désormais pris son envol. Retour sur la naissance et l’esprit d’une aventure née au Mali avec le musicien Chris Eckman, l’un des deux fondateurs du label.
Article mis à jour le 15 octobre 2018
 Écoutez notre playlist Glitterbeat
Écoutez notre playlist Glitterbeat
Comment t’es tu retrouvé dans l’aventure Glitterbeat, un label fondé en 2013 ?
Monter le label n’a pas été une décision spontanée. J’ai commencé à voyager au Mali il y a environ dix ans, d’abord comme simple voyageur à la recherche de nouvelles expériences musicales, en mélomane, et pas en musicien. Je voulais simplement en savoir plus sur la musique en général, et je ressentais le besoin d’explorer de nouveaux endroits et d’y découvrir des traditions et des musiques inconnues. J’y ai donc d’abord passé quatre ou cinq semaines.
Et pourquoi avoir choisi le Mali ?
Un ami y était allé pour faire du field-recording à la fin des années 1990. Il a ensuite sorti ces enregistrements sur Sublime Frequencies, un label de Seattle – d’où je suis originaire. Il a sorti deux albums pour eux, l’un enregistré au Maroc, l’autre au Mali. À son retour du Mali, il m’a fait écouter son travail, et cette musique était très nouvelle à mes oreilles. Cela faisait des années que j’écoutais de la musique africaine, mais essentiellement du Nigéria et du Ghana, et des choses plutôt rythmiques. C’était si nouveau pour moi que je suis devenu obsédé non seulement par la musique, mais aussi par l’idée d’aller sur place. C’était ma première approche de la musique malienne.
En dehors de mes voyages musicaux, j’y suis aussi allé avec des amis, et notamment Peter Weber, qui s’occupe du label Glitterhouse depuis plusieurs années. Lors d’un de nos voyages, nous avons fait la connaissance de ce jeune groupe originaire de Kidal, nommé Tamikrest. J’étais avec mes amis de Dirtmusic, un groupe qu’on a monté ensemble. On en a profité pour faire une collaboration. Par la suite, Peter est devenu le manager de Tamikrest et petit à petit, après ce premier projet et d’autres voyages pour produire des artistes locaux, nous avons décidé de monter notre label pour sortir cette musique. Au départ, l’idée était de sortir la musique qu’on produisait là-bas. Peter et moi étant amis depuis longtemps, nous nous sommes dit que nous allions faire un sous-label de Glitterhouse spécialisé dans cette musique du Mali qui nous obsédait tant. Ça a duré une année, avant que nous ne décidions de monter notre propre affaire.
Nous avons fait les choses pas à pas, sans même savoir que nous finirions par monter un label.
La musique du Mali était très différente du reste. Qu’est-ce qui vous a plu en elle ? (le catalogue de Glitterbeat contient beaucoup de disques maliens)
C’est avec le Mali que nous avons commencé : c’est la musique que nous connaissions, et le pays dans lequel nous avons rencontré des amis. Ça s’est donc fait très naturellement. Nous n’avons pas fait le tour du Mali pour signer des groupes, et nous n’avons jamais prétendu être les employés d’une maison de disques. Nous avons fait les choses pas à pas, sans même savoir que nous finirions par monter un label. Nous avons fait la connaissance d’artistes et certains nous ont demandé de produire leur disque, et de les aider à trouver un label. Nous répondions « peut-être », et la collaboration pouvait commencer, à un niveau très basique.
Mais ce qui est intéressant avec la musique du Mali – même si elle est en réalité très variée – c’est son lien avec ce qu’on appelle les « gammes pentatoniques » et le « blues ». Pour qui est habitués à la musique afro-américaine, ce lien est évident : c’est une musique qui a voyagé depuis cette région jusqu’aux Caraïbes, a ensuite rejoint les côtes d’Amérique du Nord, pour finalement revenir à ses origines, en un sens. C’est pourquoi il peut y avoir une sensation de familiarité avec cette musique, qui en même temps semble si loin de nous. Je pense que c’est un entre-deux assez étrange pour les Occidentaux. Et c’est sans doute ce qui m’a attiré.
En parlant de ta rencontre avec Tamikrest, c’est bien sur Glitterhouse que leur premier album, Adagh, est sorti ?
Nous n’avions pas encore Glitterbeat à ce moment. Et puisque Peter s’occupait de Glitterhouse, nous avons sorti l’album sur ce label, ce qui était très surprenant, vu le type de musique. C’était en fait la chose la plus simple à faire, et aussi une manière pour nous de nous assurer que les choses seraient réglo au niveau juridique, administratif, etc… Peter jouait aussi le rôle de protecteur du groupe, parce que les membres étaient très jeunes – dans leur vingtaine – et ils n’avaient alors aucune expérience en dehors de l’Afrique. La première fois que Ousmane [le leader de Tamikrest] est venu en Europe – à Paris et à Berlin – j’étais avec lui. C’était une sacrée aventure pour eux, et un véritable changement de perspective pour quelqu’un qui avait vécu dans le désert toute sa vie. J’ai produit les trois premiers albums de Tamikrest. Le premier, Adagh, a été enregistré à Bamako dans le très célèbre studio Bogolan, fondé par Ali Farka Touré. C’était un groupe vraiment intéressant parce que bien qu’ils venaient du fin fond du désert – Kidal est littéralement situé aux confins du monde – ils avaient là-bas la Maison du Luxembourg, un lieu financé par le Luxembourg, avec un petit studio d’enregistrement fonctionnant sur ordinateur portable. Quand on a rencontré les membres du groupe, ils nous ont dit qu’ils avaient déjà enregistré quelques chansons, et lorsqu’ils nous les ont envoyées, j’ai été vraiment étonné. Ils avaient fait un véritable enregistrement de studio, avec des overdubs…
Donc lorsqu’on a enregistré à Bamako, ils connaissaient déjà très bien le fonctionnement du studio, et ils ont mené eux-mêmes les choses, comme tout artiste devrait faire. Ça a été une expérience géniale. Nous avons travaillé très rapidement, et je crois que l’album a été enregistré en cinq jours seulement. Un moment rempli de joie.
Tu parles de blues, mais il y aussi une touche rock’n’roll dans certaines sorties de Glitterbeat…
Les artistes africains en connaissent en rayon, et sur beaucoup de choses ! Prends Ben Zabo par exemple : il écoute énormément de rock, d’où le son de son album. Et encore une fois, on l’a fait très rapidement, sans la possibilité de trop réfléchir à la vision du projet, ou de changer la composition du groupe.
J’étais sur place, comme le font souvent les producteurs, mais seulement pour m’assurer que les choses prenaient le bon chemin. Si c’est le cas, je me tiens à l’écart, et je laisse le groupe faire ce qu’il sait si bien faire. C’est la même chose avec Tamikrest, et leurs influences rock n’ont aucun lien avec moi : ils aiment vraiment Dire Straits, Carlos Santana, Jimi Hendrix… ils écoutent Bob Marley depuis des années. Ce dialogue qu’ils ont avec le rock, et aujourd’hui avec les musiques électroniques, est bien ancré en Afrique de l’Ouest. Ce n’est pas forcément quelque chose que les producteurs ou labels occidentaux leur ont apporté, en demandant aux groupes de rajouter une batterie ici ou autre chose là. Il s’agit tout simplement de la musique telle qu’ils la jouent !
Mon travail est de rendre le son le plus net possible, de m’assurer que l’ambiance dans le studio est excellente et que les chansons marchent bien. Rien de plus.
J’ai dû produire environ 40 disques pour d’autres artistes au fil du temps, dont sept ou huit en Afrique. Je procède toujours de la même façon, parce que je considère que c’est le disque de l’artiste, et pas le mien. Mon travail est de rendre le son le plus net possible, de m’assurer que l’ambiance dans le studio est excellente, que tout le monde est détendu, et que les chansons marchent bien. Rien de plus. Je ne cherche jamais à arranger les chansons, et je n’ai jamais vu mon rôle de producteur ainsi, que ce soit à Bamako, à Ouaga, à Seattle ou en Slovénie où j’habite actuellement. Il y a plein de façons de faire, mais j’ai toujours décidé de laisser l’artiste faire.
Sur quels critères choisissez-vous les artistes ?
Depuis quatre ans, nous ne sommes plus un label uniquement malien : nous travaillons avec des artistes du Brésil, des États-Unis… la différence, c’est que beaucoup d’artistes nous sollicitent directement désormais. C’est un peu comme si on faisait notre marché et qu’on prenait ce dont on avait envie. On n’a jamais perdu cet état d’esprit. Je dirais même qu’on est encore plus convaincu que c’est la bonne façon de faire, quatre ans après avoir lancé le label.
Peux-tu nous parler de l’album de Lobi Traoré sorti en 2010, après sa mort ?
L’histoire de Lobi est incroyable. Je l’ai vu sur scène lors de mon troisième séjour au Mali et il m’a retourné. Le concert était encore meilleur que ce que j’avais imaginé. À ce moment, nous étions en train d’enregistrer un album pour Dirtmusic, et Lobi nous a dit qu’il passerait au studio. Nous étions très excités ! Le lendemain, le voici qui arrive au studio… pour enregistrer son propre album ! Il était déjà prêt. Mais nous devions d’abord finir notre disque.
Quand je suis revenu pour enregistrer le disque de Tamikrest, six mois plus tard, on m’a dit que Lobi comptait venir au studio. Malheureusement, je ne restais pas assez longtemps sur place et nous n’avions pas l’argent pour enregistrer un groupe au complet. Je lui ai donc lancé : « tu n’as qu’à venir avec ta guitare acoustique, tu sais, comme John lee Hooker assis devant un micro ». Il est venu, je l’ai enregistré, et c’est une des choses les plus incroyables que j’ai pu voir et entendre à ce jour. Il est simplement resté assis sur sa chaise, à jouer.
« Tu as soif ?
– Non.
– Tu veux déjeuner ?
– Non. »
Il a enregistré sans s’arrêter pendant deux heures, puis il s’est rendu à un mariage. Et nous avions le disque.
Malheureusement, le matin même où j’ai fini le visuel de ce disque, Rainy Season Blues, j’ai reçu un e-mail d’un DJ malien qui travaille à la radio anglaise, qui m’annonçait que Lobi venait de mourir. Je m’apprêtais à envoyer le visuel à Lobi pour qu’il me dise ce qu’il en pense. C’était donc un moment très bizarre, quasi surréel… mais j’ai quand même eu énormément de chance de pouvoir travailler avec lui. Le disque est finalement sorti en 2010.
Au fil du temps, Glitterbeat a élargi sa palette musicale, et s’est éloigné des sons d’Afrique.
La musique… la culture est un métissage, par définition. Souvent, les gens imaginent qu’une culture peut être pure, mais dès qu’on y réfléchit sérieusement et avec l’esprit suffisamment ouvert, on se rend compte que les cultures se transforment en permanence. Sans doute changent-elles encore plus rapidement aujourd’hui, avec le numérique et le niveau de communication actuel, et pourtant on croit encore qu’il existait un âge d’or pendant lequel les cultures étaient meilleures qu’aujourd’hui, plus pures, etc… C’est sans doute une vision de l’esprit : on sait très bien qu’on joue de la guitare électrique au Congo depuis les années 50 ! On ne peut pas empêcher le dialogue entre les cultures, et c’est tant mieux. Il n’y a rien de plus fascinant pour un musicien que de jouer avec des gens qui viennent d’un autre horizon culturel que lui. Et ce qui est triste avec ce genre de collaboration, c’est que lorsqu’un Français ou un Nord-Américain va à Bamako pour jouer avec des musiciens locaux, on le critique : « pourquoi il n’a pas laissé jouer les Maliens entre eux ? C’est leur musique ! » Il est clair que certaines de ces collaborations n’ont pas été faites dans le respect des musiciens locaux, mais quand j’en parle à Ousmane, lui me demande : « tu crois qu’on peut avoir Robert Plant au chant sur notre album ? ». Si tu as l’esprit ouvert, tu voudras jouer avec des musiciens à l’esprit ouvert, quelle que soit leur origine. Ça n’a pas d’importance, tant que la musique que tu fais avec eux est intéressante. Je n’ai rien contre la musique plus traditionnelle, au contraire, toutes les musiques peuvent co-exister, et je crois même que c’est quand tout se mélange que les choses deviennent le plus intéressant.
Il est grand temps d’abandonner l’idée de world music.
J’imagine donc que tu n’es pas un défenseur du terme « world music » ou « musiques du monde » ?
Je n’ai jamais vraiment apprécié cette expression, et on était d’accord avec ça dès le début de Glitterbeat. J’imagine que ce concept de « world music » a été pertinent à un moment dans le passé, à une époque où des gens du business de la musique, très bien intentionnés et créatifs, ont voulu élargir la palette de ce qui s’écoutait dans les pays occidentaux. Ils pensaient qu’en mélangeant ces musiques ensemble, ils allaient plus facilement toucher les gens. Mais je crois que ce n’est plus nécessaire aujourd’hui, et qu’il est grand temps d’abandonner cette idée. On le voit chaque jour : l’Afrique elle-même s’urbanise à vitesse grand V, et les musiques urbaines se libèrent et dialoguent avec le monde, affranchies des labels comme Glitterbeat ou d’un producteur comme moi. Elles dialoguent de plus en plus avec les musiques du monde entier, avec la pulsation électronique mondiale, et personne ne pourra les arrêter, parce que c’est un mouvement spontané. Le monde numérique dans lequel on baigne accélère tout, et nous oblige à suivre le rythme. C’est le chemin que prend le monde, et je dois reconnaître qu’aujourd’hui, un artiste qui sort sa musique lui-même (sur Bandcamp ou ailleurs) est un vrai artiste contemporain. On lui doit un profond respect. Beaucoup de gens partagent ce même sentiment et il faut le dire haut et fort : la musique d’aujourd’hui ne vient pas de Berlin, de Londres, ou d’une grande ville d’Europe ou d’Amérique du Nord, mais elle vient du Cap, de Nairobi ou de Hanoï, et elle est faite par des artistes de musique contemporains.
Lire ensuite : ‘Quebra Cabeça’ : l’afrobeat toujours plus urbain des Brésiliens de Bixiga 70
Photo une de l’article : Ousmane Mossa (Tamikrest) et Chris Eckman. Ljubljana, November 2013. Photo by Jaka Babnik